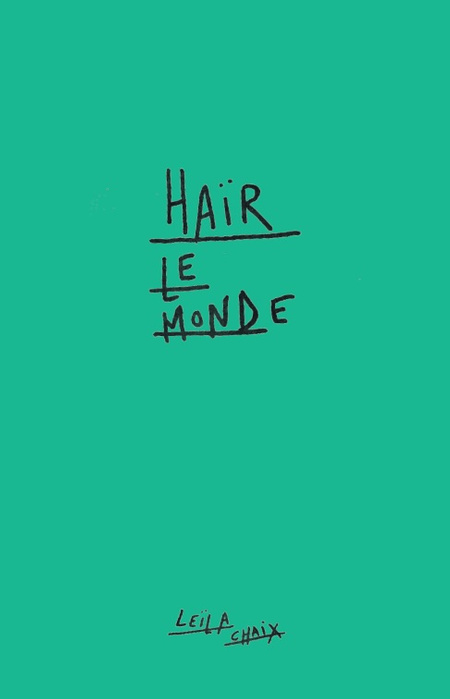Jorge profond
La révolution est une course de fond
Ce n’est pas un ramenard, l’ami Jorge Valadas. Il n’écrit pas pour la gloriole, pour conter ses exploits de vieux routier du militantisme international. Dans Itinéraire du refus, il entreprend de saisir ce qui, dès l’enfance, conduit par petites touches à forger une identité politique, un imaginaire, un refus de l’existant.
Né à Lisbonne en 1945, il a grandi dans une société menée de main de fer par le fantoche Salazar au pouvoir depuis 1932, avec la complicité d’une Église catho aussi rétrograde qu’omniprésente. Pas jojo. Le jeune Jorge comprend vite qu’il est de l’autre camp. Sa vision des salazaristes à douze ans : « Je les vois comme des sosies du bouffon général Tapioca et du fourbe Olrik qui répandent leurs méchancetés dans les épisodes de Tintin et de Blake et Mortimer. »
La suite s’écrit par épisodes plus ou moins douloureux. La distance grandissante avec le père, généreux, aimant, mais admirateur de Salazar. La découverte si remuante de la littérature, puis de Marx & cie. Les années dans la marine militaire à s’ennuyer sur le bel océan (sa consolation) en sabotant gentiment la routine. Et puis, en ce temps de guerres coloniales sanglantes (en Angola, au Mozambique), alors que Salazar professe « l’empire c’est la nation », ce choix qui d’un coup se fait impérieux : la désertion.
« Mai 68, puis la révolution portugaise, m’ont permis de réparer pour beaucoup la blessure de l’exil »
C’est ainsi qu’en juillet 1967 Jorge débarque dans un Paris qui l’étourdit. Il se cherche. « Je débarque du Moyen Âge ibérique », dit-il. Il sonne à la porte du Parti communiste, qui l’écœure. Se fait draguer par les trotskystes, qui l’assomment de leur bréviaire. Refuse le culte de Mao. Alors il trouve des interstices, lit Rosa Luxemburg, se forge un marxisme où l’autoritarisme n’a pas sa place. Cavalant partout pendant Mai 68, de comités d’actions en grève sur son lieu de travail, il va aussi « distribuer des tracts dans les bidonvilles portugais de la banlieue ».
La flamme retombée, il ne lâche rien. Se retrouve embarqué en 1972 dans une histoire de livraison de littérature séditieuse au Portugal par le biais de sous-marins que le régime honni vient d’acheter à la France : « C’est ainsi que des milliers de revues et de brochures arrivent par des bonnes mains, à Lisbonne, pour trouver diffusion dans les milieux de la jeunesse, avide d’idées révolutionnaires sentant encore bon l’odeur des barricades parisiennes. »
La révolution des Œillets, en 1974, est évidemment un firmament pour lui, même s’il a peu de doutes sur sa récupération sociale-démocrate. « Mai 68, puis la révolution portugaise, m’ont permis de réparer pour beaucoup la blessure de l’exil », lâche-t-il. « Ces moments lumineux de subversion de l’ordre gris ont éclairé ma vie. » De là, il restera le même, toujours à l’affût des mouvements sociaux, toujours présent dans les manifs. Une vie à lever le poing, sans bravade, juste pour contrer le gris.
Cet article fantastique est fini. On espère qu’il vous a plu.
Nous, c’est CQFD, plusieurs fois élu « meilleur journal marseillais du Monde » par des jurys férocement impartiaux. Plus de vingt ans qu’on existe et qu’on aboie dans les kiosques en totale indépendance. Le hic, c’est qu’on fonctionne avec une économie de bouts de ficelle et que la situation financière des journaux pirates de notre genre est chaque jour plus difficile : la vente de journaux papier n’a pas exactement le vent en poupe… tout en n’ayant pas encore atteint le stade ô combien stylé du vintage. Bref, si vous souhaitez que ce journal puisse continuer à exister et que vous rêvez par la même occas’ de booster votre karma libertaire, on a besoin de vous : abonnez-vous, abonnez vos tatas et vos canaris, achetez nous en kiosque, diffusez-nous en manif, cafés, bibliothèque ou en librairie, faites notre pub sur la toile, partagez nos posts insta, répercutez-nous, faites nous des dons, achetez nos t-shirts, nos livres, ou simplement envoyez nous des bisous de soutien car la bise souffle, froide et pernicieuse.
Tout cela se passe ici : ABONNEMENT et ici : PAGE HELLO ASSO.
Merci mille fois pour votre soutien !
Cet article a été publié dans
CQFD n°240 (avril 2025)
Dans ce numéro, un grand dossier « ruralité ». Avec des sociologues et des reportages, on analyse le regard porté sur les habitants des campagnes. Et on se demande : quelles sont leurs galères et leurs aspirations spécifiques, forcément très diverses ? Et puis, comment faire vivre l’idée de gauche en milieu rural ? Hors dossier, on tient le piquet de grève chez un sous-traitant d’Audi en Belgique, avant de se questionner sur la guerre en Ukraine et de plonger dans l’histoire (et l’héritage) du féminisme yougoslave.
Trouver un point de venteJe veux m'abonner
Faire un don
Paru dans CQFD n°240 (avril 2025)
Dans la rubrique Bouquin
Par
Mis en ligne le 04.04.2025
Dans CQFD n°240 (avril 2025)
Derniers articles de Émilien Bernard