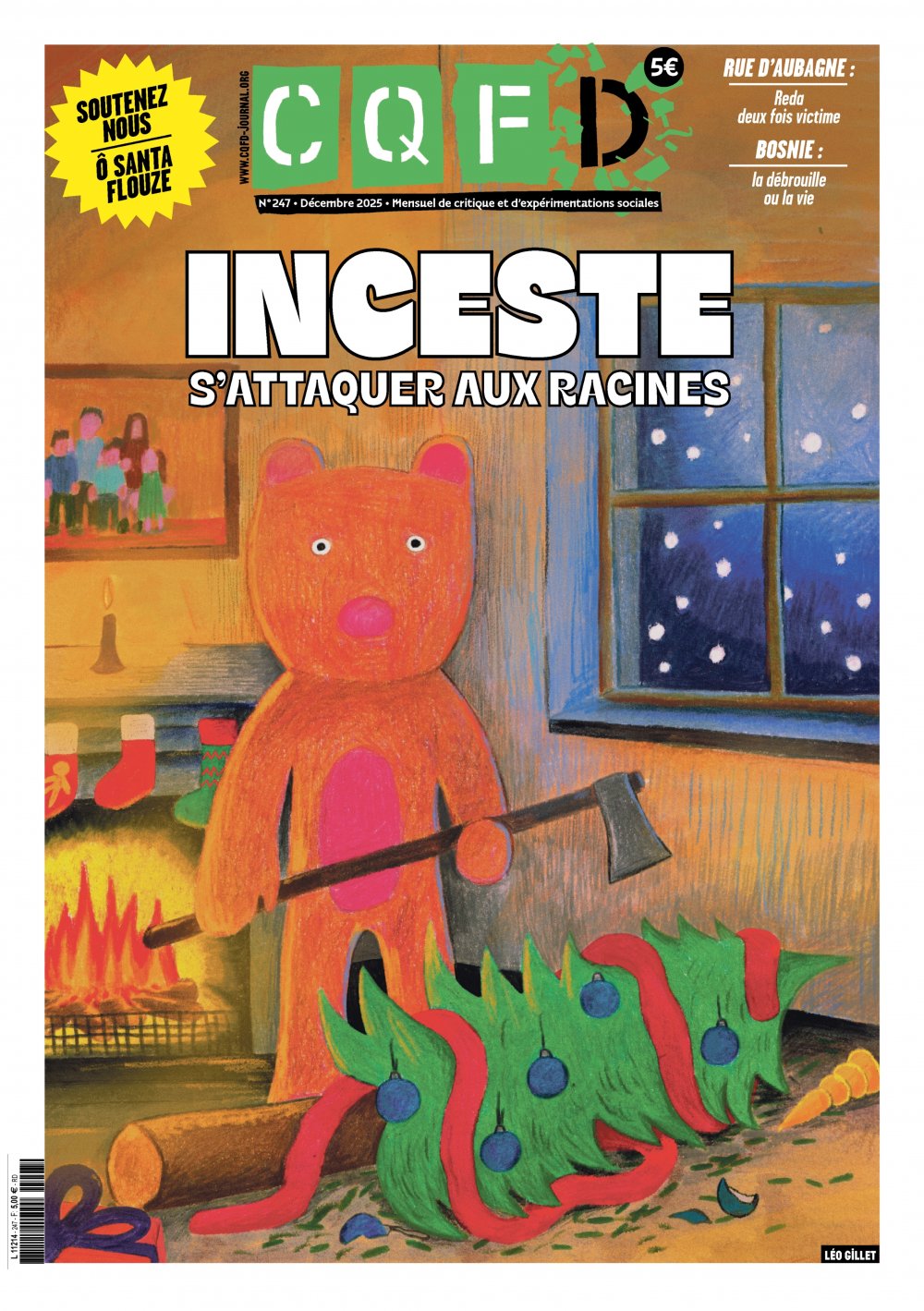Dossier
Ce temps qu’on nous vole

Jadis, le champ de bataille était d’une clarté limpide : d’un côté les vampires exploiteurs, de l’autre ceux dont on volait l’existence. Le patron ventru à chapeau Monopoly versus les ouvriers à qui l’on arrachait la moindre minute de productivité. Ce qui permettait à tonton Marx de poser l’équation sans détour : « Un homme qui ne dispose d’aucun loisir, dont la vie tout entière, en dehors des simples interruptions purement physiques pour le sommeil, les repas, etc., est accaparée par son travail pour le capitaliste, est moins qu’une bête de somme. C’est une simple machine à produire de la richesse pour autrui, écrasée physiquement et abrutie intellectuellement. »1
Pour le mouvement ouvrier des XIXe et XXe siècles, la lutte pour le temps a donc été, en quelque sorte, la mère de toutes les batailles. À force de grèves, de manifestations et autres émeutes, un lent processus a abouti à une réduction substantielle du temps de travail (lire pp. II & III), sans pour autant briser la voracité des voleurs de vie.
Aujourd’hui encore, « l’usine te bouffe le temps, le corps et l’esprit », témoigne l’écrivain Joseph Ponthus, qui a besogné deux ans dans les abattoirs bretons (pp. IV & V). L’actuel monde du travail regorge aussi de nouvelles formes d’exploitation effarantes, basées notamment sur la précarité, le temps partiel subi, l’intérim. Certes, on ne trime plus 16 heures par jour mais, sur fond de chômage de masse, on se doit d’être disponible à tout instant pour recueillir la moindre heure de boulot qu’un généreux patron daignera nous confier. Le capital voleur de temps n’est plus cantonné à l’usine, mais croît hors de son foyer originel, se démultiplie, floutant la frontière entre temps libre et temps de (télé)travail – cf. le désormais habituel mail « urgent » du chef de service à 23 h 17.
Au fil du temps, la machine de dépossession s’est perfectionnée. Et la question du temps volé et de sa nécessaire réappropriation, qui a longtemps infusé, de Paul Lafargue (Le Droit à la paresse, 1883) à Raoul Vaneigem (Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations, 1967), a fini par se dédoubler avec l’avènement de ladite société de loisirs, encouragée par la course aux échalotes technologiques.
Ces fameuses « nouvelles technologies » nous promettent toujours un gain de temps, un confort. Mais en retour, elles nous assènent ce coup de bâton vertigineux qu’on appelle l’accélération. Car ce temps prétendument dégagé par les outils techniques, nous n’en jouissons pas. Très vite, il est accaparé par d’autres sollicitations, toujours plus nombreuses. Sans relâche, il faut désormais non seulement travailler, mais aussi consommer, s’amuser, s’informer… Plus de temps, ni de lieu de répit : nous voilà connectés en permanence. C’est le rêve de la Silicon Valley et de ses hérauts, par exemple l’ex saint patron de Google, Eric Schmidt (p. VII), troubadour décomplexé d’une nouvelle civilisation où des gadgets miraculeux raccordés au réseau 5G (pp. VIII & IX) répondront à tous nos manques en envahissant nos vies, pour nous connecter et nous connecter encore jusqu’à l’orgasme techno-existentiel.
Mais la technologie n’est pas le seul moteur de cette société accro à la vitesse. En cause également, l’idéologie du tous contre tous, ou l’autre est forcément concurrent, homme ou femme à (a)battre dans la compétition du quotidien. Pour ne pas perdre sa place, il ne faut donc pas traîner en route, dénonce le philosophe Hartmut Rosa (p. VI), selon qui « les normes temporelles prennent un aspect quasiment totalitaire ».
La crise Covid a eu à cet égard un effet positif. Un temps la machine a stoppé, accélération en berne. Le confinement, certes anxiogène, a offert un aperçu de ce que pourrait être un monde débarrassé de l’obsession de la productivité über alles. Mais les promoteurs de cette dernière ne lâcheront rien, quitte à foncer droit dans le mur – comme l’a bien résumé la journaliste Naomi Klein dans un récent entretien au Monde 2 :
« À chaque fois que nous essayons d’accélérer pour revenir au niveau où nous étions avant la pandémie, le virus se propage de nouveau. On le voit dans les usines, qui redémarrent puis doivent fermer une nouvelle fois. Accélérer, c’est ce que le capitalisme veut que nous fassions. Le secteur des technologies veut que nous travaillions plus vite qu’auparavant, mais de chez nous. Mais la vitesse est l’ennemi. La bonne question à se poser, c’est comment nous pouvons vivre bien, de manière à protéger notre santé et celle de la planète. […] Je crois que beaucoup de gens ont ressenti d’une manière très viscérale, lors de cette crise, à quel point notre système économique est en guerre avec la vie sur Terre. Car lorsque l’économie s’arrête, nos systèmes naturels commencent à récupérer. »
Ce « système économique en guerre avec la vie sur Terre » ne baissera pas les bras de lui-même. Le capitalisme est en effet champion dans l’art de se renouveler face aux obstacles pour toujours mieux essorer, caméléon surdoué qui a su s’adapter, par exemple, à l’essor de l’écologie tiédasse, peignant ses avatars en vert (et contre tout). Partout, il est comme chez lui, s’invitant sur notre canapé, notre lit et nos écrans.
Et s’il est navrant de devoir encore le rappeler, c’est à la base même qu’il faut l’attaquer, aux racines. Démissionner. Refuser. Prôner la sieste – ou l’incendie. Contre-attaquer. Briser le réveil. Faire l’amour. Abattre les antennes voraces. Divaguer. Admirer les (dernières) lucioles. Faire la bombe (tic-tac tic-tac). Ériger un empire de hamacs. Préférer ne pas. Baffer son conseiller Pôle emploi. Graisser les matinées. Lever le majeur ou le poing. Tout brûler. Pas de temps à perdre. ■
Cet article fantastique est fini. On espère qu’il vous a plu.
Nous, c’est CQFD, plusieurs fois élu « meilleur journal marseillais du Monde » par des jurys férocement impartiaux. Plus de vingt ans qu’on existe et qu’on aboie dans les kiosques en totale indépendance. Le hic, c’est qu’on fonctionne avec une économie de bouts de ficelle et que la situation financière des journaux pirates de notre genre est chaque jour plus difficile : la vente de journaux papier n’a pas exactement le vent en poupe… tout en n’ayant pas encore atteint le stade ô combien stylé du vintage. Bref, si vous souhaitez que ce journal puisse continuer à exister et que vous rêvez par la même occas’ de booster votre karma libertaire, on a besoin de vous : abonnez-vous, abonnez vos tatas et vos canaris, achetez nous en kiosque, diffusez-nous en manif, cafés, bibliothèque ou en librairie, faites notre pub sur la toile, partagez nos posts insta, répercutez-nous, faites nous des dons, achetez nos t-shirts, nos livres, ou simplement envoyez nous des bisous de soutien car la bise souffle, froide et pernicieuse.
Tout cela se passe ici : ABONNEMENT et ici : PAGE HELLO ASSO.
Merci mille fois pour votre soutien !
1 Salaire, prix et profit, 1865.
2 « Seule une réponse très audacieuse à la crise nous mènera quelque part » (07/06/2020).
Cet article a été publié dans
CQFD n°190 (septembre 2020)
Trouver un point de venteJe veux m'abonner
Faire un don
Paru dans CQFD n°190 (septembre 2020)
Dans la rubrique Le dossier
Illustré par Gwen Tomahawk
Mis en ligne le 25.12.2021
Articles qui pourraient vous intéresser
Dans CQFD n°190 (septembre 2020)