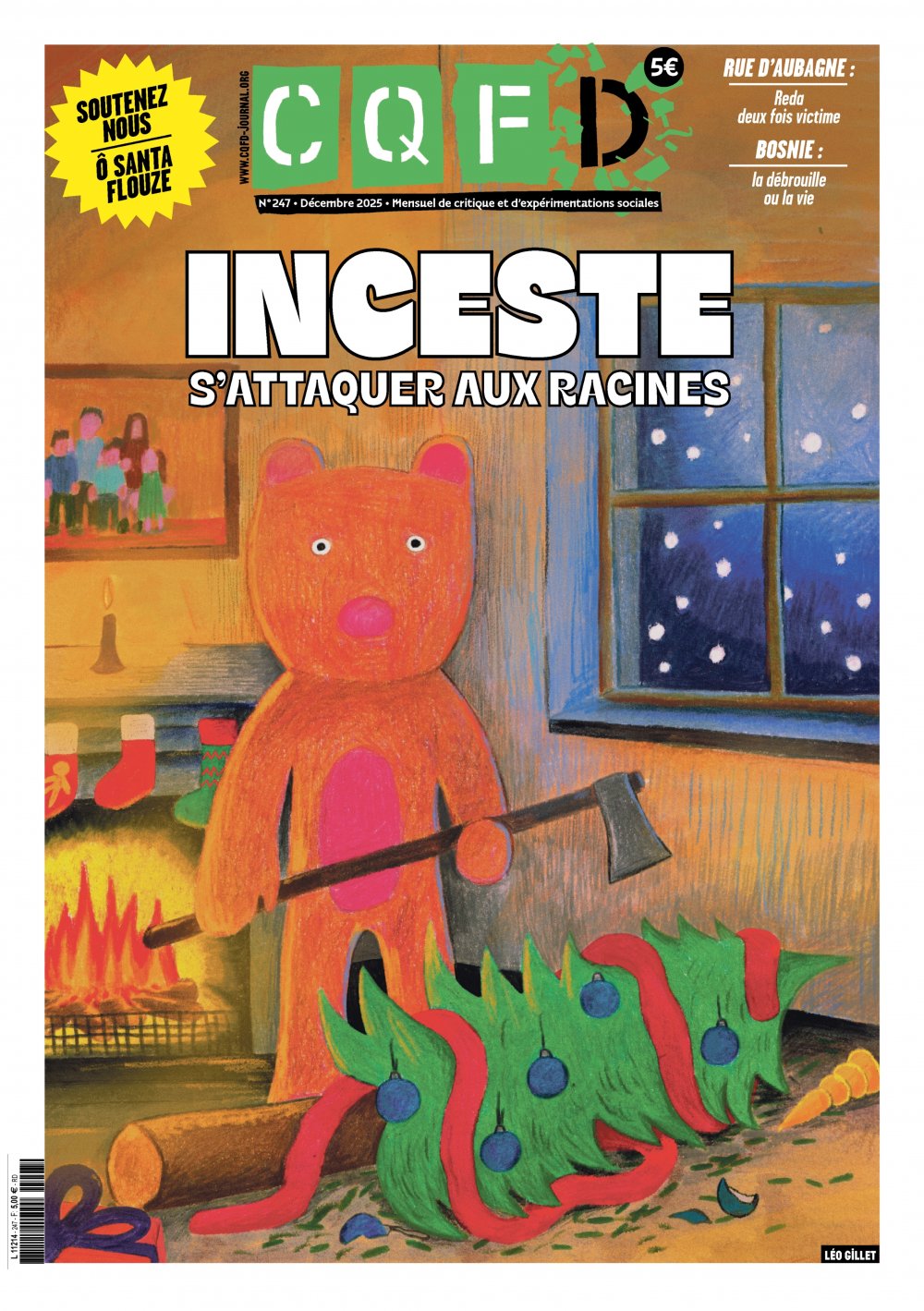Au Mexique, « pas une morte de plus »
La rue et la nuit nous appartiennent aussi !
« Justice ! Justice ! Justice ! » ; « Ce n’est pas un suicide, c’est un féminicide ! » ; « Nous nous voulons vivantes ! » Clamés par des familles de victimes de féminicides, des activistes, des féministes, ces slogans inondent le Paseo de la Reforma comme les périphéries de Mexico. « Je veux rentrer chez moi libre et non armée de courage ! » ; « Pas une de plus, pas une morte de plus » : des mots qui résonnent du port de Veracruz à la ville frontalière de Ciudad Juárez et sur les principales places centrales des villes du pays.
Avec sa batucada féministe et ses clameurs de justice, la vague violette submerge le pays, particulièrement depuis 2014. Les manifestations ne se limitent pas au 25 novembre, Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, ni au 8 mars, Journée internationale de la femme. Au Mexique, il n’y a pas suffisamment de dates officielles pour dénoncer les neuf assassinats quotidiens de femmes (chiffre des Nations unies). Ni d’ailleurs pour se souvenir des victimes des 1 666 féminicides documentés entre 1993 et 2016 à Ciudad Juárez, lieu des premiers débats sur le sujet. Ces trois dernières années, 2 560 cas de féminicides ont été répertoriés par le secrétariat exécutif du Système national de sécurité publique : le bilan annuel a augmenté de 104 % entre 2015 et 2018.
Féminicide, ou plutôt femicide, est un terme créé en 1976 par les anthropologues américaines Diana Russell, Jill Radford et Jane Caputi, à destination du Tribunal international des crimes contre les femmes (grand rassemblement féministe qui se tint à Bruxelles du 4 au 8 mars 1976), pour désigner « le meurtre misogyne de femmes par des hommes1 ». Plus tard, le concept sera traduit comme féminicide (en espagnol feminicidio) par l’anthropologue mexicaine Marcela Lagarde et introduit dans le pays en 1998 pour désigner la vague d’assassinats de femmes ayant débuté à Ciudad Juárez en 1993 avant de se propager aux quatre coins du pays.
Le cri de justice et la visibilisation des victimes de crimes machistes renvoient à l’histoire contemporaine d’un Mexique plongé dans une atroce violence qui, si elle remonte à l’époque de la « guerre sale » (féroce répression d’État entamée dans les années 1960 et qui s’est poursuivie jusqu’aux années 1990), s’est intensifiée au cours des deux derniers mandats présidentiels de Felipe Calderón (2006-2012) et d’Enrique Peña Nieto (2012-2018).
En 2006, le gouvernement de Calderón lance la « guerre contre la drogue » qui a fait jusqu’ici 250 000 morts et près de 40 000 disparus2. Cette politique anti-drogues est poursuivie par Peña Nieto. Pendant son mandat, la violence à l’encontre des défenseuses de droits humains et des journalistes femmes augmente, tout comme le nombre de féminicides et de disparitions forcées (dont celle, emblématique, des 43 étudiants d’Ayotzinapa en septembre 2014). Parallèlement, l’avortement demeure criminalisé.
Sous le mandat de Peña Nieto et de l’actuel président Andrés Manuel López Obrador, les mobilisations contre le féminicide ont été lancées à l’initiative de jeunes femmes issues de divers contextes géographiques, de classes sociales et d’origines ethniques différentes ; d’identités de genre, de niveaux d’études et de professions éclectiques. Lors des rassemblements, elles entonnent des slogans féministes, dénoncent le harcèlement et les abus sexuels et exigent un avortement libre et gratuit. Elles pointent aussi du doigt un État qui compromet impunément la sécurité des femmes et des jeunes filles, chez elles et dans la rue, en protégeant les auteurs de maltraitance, les familles violentes et le crime organisé.
Ce sont ces jeunes des métropoles, des banlieues, issues des peuples autochtones, étudiantes dans le secondaire ou dans le supérieur, migrantes, travailleuses ou sans emploi formel, qui sont venues grossir les statistiques les plus récentes du féminicide. Et ce sont ces mêmes femmes qui, le poing levé, ont adopté à l’unisson le slogan « ¡ Ni una menos ! ¡ Vivas nos queremos ! », devenu le cri de lutte de la nouvelle génération d’activistes féministes au Mexique.
Cet article fantastique est fini. On espère qu’il vous a plu.
Nous, c’est CQFD, plusieurs fois élu « meilleur journal marseillais du Monde » par des jurys férocement impartiaux. Plus de vingt ans qu’on existe et qu’on aboie dans les kiosques en totale indépendance. Le hic, c’est qu’on fonctionne avec une économie de bouts de ficelle et que la situation financière des journaux pirates de notre genre est chaque jour plus difficile : la vente de journaux papier n’a pas exactement le vent en poupe… tout en n’ayant pas encore atteint le stade ô combien stylé du vintage. Bref, si vous souhaitez que ce journal puisse continuer à exister et que vous rêvez par la même occas’ de booster votre karma libertaire, on a besoin de vous : abonnez-vous, abonnez vos tatas et vos canaris, achetez nous en kiosque, diffusez-nous en manif, cafés, bibliothèque ou en librairie, faites notre pub sur la toile, partagez nos posts insta, répercutez-nous, faites nous des dons, achetez nos t-shirts, nos livres, ou simplement envoyez nous des bisous de soutien car la bise souffle, froide et pernicieuse.
Tout cela se passe ici : ABONNEMENT et ici : PAGE HELLO ASSO.
Merci mille fois pour votre soutien !
1 « “It’s a Crisis of Civilization in Mexico.” 250 000 Dead. 37,400 Missing. », The Wall Street Journal (14/11/2018).
2 Radford, Jill et Diana E. H. Russell, Femicide. The politics of Woman Killing, Buckingham : Open University Press, 1992.
Cet article a été publié dans
CQFD n°178 (juillet-août 2019)
Trouver un point de venteJe veux m'abonner
Faire un don
Paru dans CQFD n°178 (juillet-août 2019)
Dans la rubrique Le dossier
Par ,
Mis en ligne le 02.10.2019
Dans CQFD n°178 (juillet-août 2019)
Derniers articles de Anna Touati
Derniers articles de Daniela Villegas