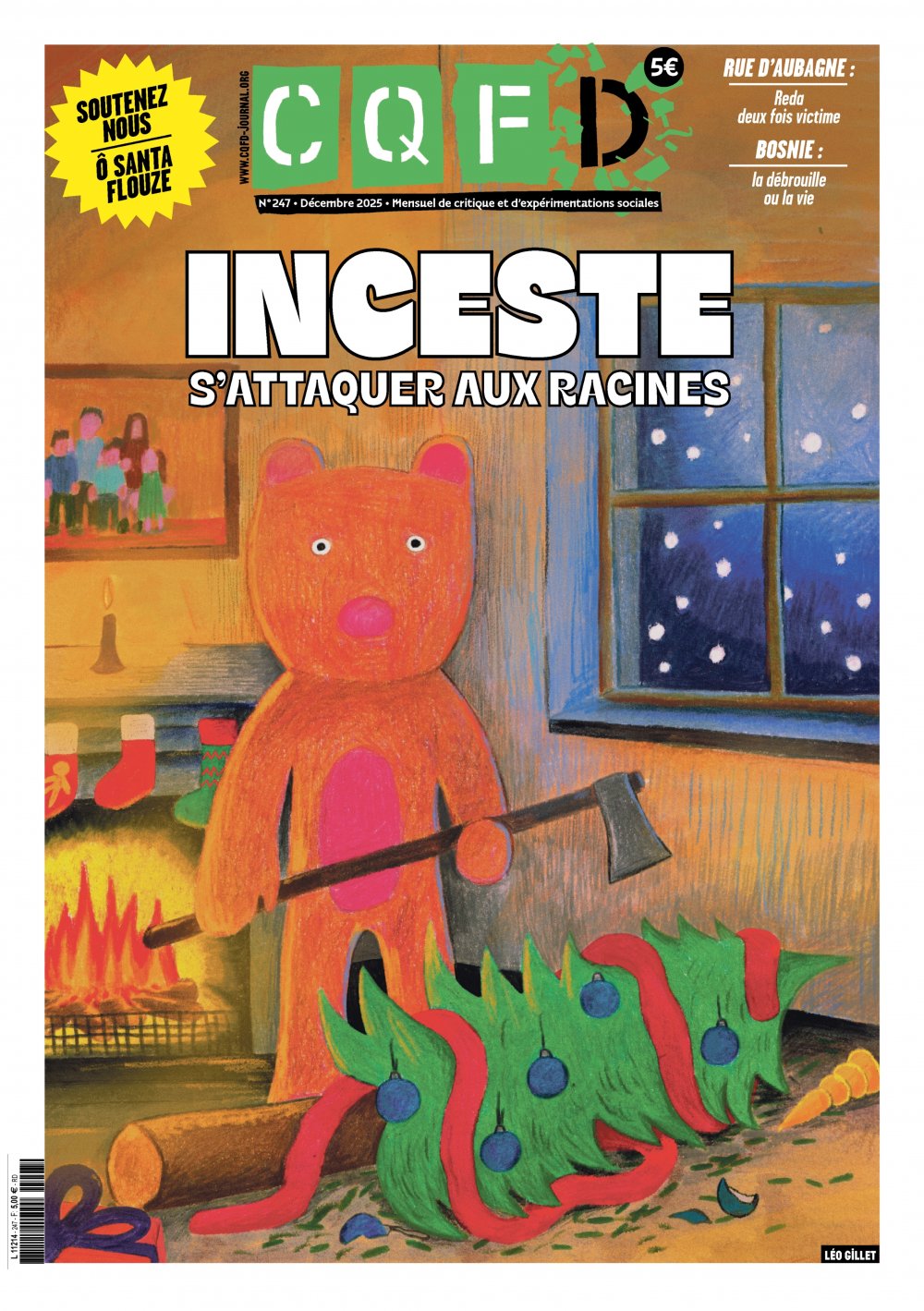Colère agricole : fumier tue
« Pousser la conscience de classe du monde paysan »
« On va tous monter, bloquer Paris ! » proférait l’orageuse Coordination rurale dix jours avant l’ouverture des élections professionnelles des chambres d’agriculture. Le syndicat « apolitique » d’extrême droite1, relayé à l’excès par des rédactions parisiennes frémissantes, espérait provoquer l’insurrection… ou tout au moins faire sa campagne électorale.
« Ces élections dépassent largement les chambres d’agriculture »
En effet, tous les six ans se renouvellent les « chambres ». Ensemble nébuleux de collèges départementaux et régionaux, elles représentent les quelque 2,2 millions d’exploitant·es agricoles, salarié·es, propriétaires fonciers et retraité·es du secteur. Mais depuis la vague de soulèvement agricole d’il y a un an, le trône de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) y est furieusement disputé. La Coordination rurale veut diriger la colère du secteur contre les normes environnementales, tandis que la Confédération paysanne dénonce les accords de libre-échange2, fondements du modèle d’agriculture intensive que promeut notamment la FNSEA depuis l’après-guerre.
Thomas Gibert, maraîcher en Haute-Vienne et secrétaire national à la Conf’, nous explique l’urgence de fédérer sa classe paysanne autour d’un nouveau modèle agricole.
⁂
On entend souvent que les chambres d’agriculture sont de simples « chambres d’enregistrement ». Pourquoi y a-t-il tant de crispation autour de leurs élections cette année ?
« En réalité, ces élections dépassent largement les enjeux des chambres, qui sont des outils assez limités. En les remportant, tu vas certes pouvoir développer quelques projets locaux, des formations, des accompagnements à l’installation et à la transmission. Mais surtout, ça permet de peser dans les négociations qui régissent la politique agricole, qui se jouent au niveau national, voire européen. Et ça permet aussi de siéger dans plein d’autres instances qui influencent le secteur agricole, mais aussi environnemental ou sanitaire. C’est donc davantage une question de rapport de force politique.
Et ce système électoral est bien verrouillé et très favorable au syndicat majoritaire, la FNSEA. La moitié des sièges est attribuée au gagnant ; l’autre moitié est répartie à la proportionnelle de l’ensemble des forces, gagnant compris. Et plus tu as de sièges, plus tu as de financements… »
Les médias ont créé le suspense sur la capacité de la Coordination rurale à passer devant la FNSEA… Il était même question que la Coordination rurale porte une « deuxième vague de mobilisation » cet hiver. Était-ce le cas ?
« Non, pas vraiment. En février-mars 2024, la base des travailleurs poussait à fond pour demander de meilleures conditions de travail, jusqu’à déborder les directions syndicales, y compris la FNSEA. Mais cet hiver, les quelques actions menées ont surtout été récupérées par les syndicats et notamment par la Coordination rurale. Après l’annonce du blocage de Paris, ses militants se sont retrouvés à 20 pélos. Ce qui est problématique, c’est que les médias leur ont fait une pub de malade, sans chercher à savoir si les gens étaient réellement mobilisés et sans revenir ensuite sur cet échec. Avec les élections des chambres, c’est pareil : on entend partout que la Coordination rurale va rafler les voix de la FNSEA parce qu’elle aurait réussi à capitaliser sur la crise agricole de l’année dernière. Mais la FNSEA a toujours été loin devant… »
« La Coordination rurale n’a pas de projet politique clair. Elle demande tout et son contraire selon les départements et ses porte-parole, avec une vision à court terme. »
Quelles revendications porte la Coordination rurale, pour être tant relayée ?
« La Coordination rurale continue de jeter du fumier devant l’Office français de la biodiversité et demande la réautorisation des pesticides. Pour elle, ces normes sont imposées par les villes, qui ne comprennent pas la réalité du travail des paysans, qui galèrent déjà à sortir un revenu et dans des conditions parfois proches de l’esclavagisme. Cette réaction est compréhensible. Mais au-delà de faire beaucoup de bruit, la Coordination rurale n’a pas de projet politique clair. Elle demande tout et son contraire selon les départements et ses porte-parole, avec une vision à court terme. Par exemple, une “année blanche de cotisations” ou un “abaissement des normes environnementales”, alors que c’est notre profession qui se prend les cancers les plus véners à cause des pesticides.
Pour nous, la Coordination rurale ne défend pas vraiment la profession, mais plutôt une certaine identité paysanne, avec des notions qui font un peu flipper genre “la terre ne ment pas”, la famille, le travail. C’est un monde agricole fantasmé vu comme une forteresse assiégée par tout le reste de la société et qu’il faudrait défendre à tout prix. »
« La cause de nos difficultés, c’est la concurrence internationale que nous imposent les accords de libre-échange »
La FNSEA s’aligne sur la Coordination rurale et demande également l’abaissement des normes environnementales. Pourtant, ce ne sont pas les intérêts des petit·es paysan·nes qu’elle défend…
« L’argumentaire de la FNSEA, c’est demander la réautorisation des pesticides pour permettre aux agriculteurs de produire davantage, à plus bas coût, et ainsi rester compétitifs. Mais en réalité, ça profite surtout aux fermes des grosses plaines céréalières qui exportent massivement leur production, pas tellement aux petits qui n’arrivent pas à se dégager un revenu. Parce que la compétition internationale se fait sur les avantages comparatifs agronomiques, dont l’utilisation de pesticides, mais surtout sur le coût du travail. Et sur ce plan, la France ne sera jamais la plus compétitive.
Il y a donc une vraie trahison des dirigeants de la FNSEA. Comme ils ont des intérêts dans l’agro-industrie3, ça les arrange bien que le débat se déporte sur la contestation des normes environnementales et non sur le système concurrentiel mondial qui asphyxie les agriculteurs. »
Comment peut-on fédérer les travailleurs agricoles sur l’enjeu de changer de modèle ?
« À la Conf’, on ne veut pas tacler les paysans qui font de l’agriculture conventionnelle : ne pas arrêter les pesticides leur permet effectivement de rester compétitifs à court terme. Alors on essaie plutôt de pousser la conscience de classe du monde paysan pour attaquer la cause de nos difficultés : la concurrence internationale que nous imposent les accords de libre-échange. Ce qu’on revendique, ce sont des solutions systémiques.
D’abord, on demande le “prix minimum garanti rémunérateur”, un prix minimal auquel chaque denrée doit être achetée. Il doit comprendre trois coûts : les charges liées à la production, la rémunération des travailleurs (au minimum le Smic) et nos cotisations pour le chômage, la retraite et la maladie. Aujourd’hui, la majorité des paysans est en dessous du Smic, sans congés, chômage ou arrêts maladie suffisants. Ce prix minimum garanti assurerait ce minimum. »
« Contre l’extrême droite qui monte à fond, il faut réaffirmer que les travailleurs étrangers ne sont pas nos ennemis »
Oui, mais alors, comment empêcher l’agro-industrie et les grosses chaînes de distribution d’aller se fournir à l’étranger ?
« En imposant aux importations d’être vendues en France à un “prix minimum d’entrée” qui serait le coût de production français pour le même produit, vérifiable sur facture. Ce n’est pas un droit de douane, qui entraînerait un repli protectionniste, mais une mesure de solidarité avec les travailleurs des pays exportateurs. Au lieu de leur imposer des modes de production via les “clauses miroir” des traités, et d’avoir cette posture impérialiste, le “prix minimum d’entrée” leur permet une marge de manœuvre pour avoir de meilleures conditions de travail. La concurrence ne se ferait alors plus sur le prix, mais sur la qualité des produits vendus. Les traités de libre-échange tirent les prix vers le bas, nous voulons tirer la qualité et les conditions de travail vers le haut.
La Coordination rurale veut instaurer une “exception agriculturelle”, qui permettrait de contrôler la qualité des importations, mais aussi d’exporter en masse, quitte à écraser les pays du Sud. Au contraire, nous portons des valeurs internationalistes. Contre l’extrême droite qui monte à fond, il faut réaffirmer que les travailleurs étrangers ne sont pas nos ennemis. »
Cet article fantastique est fini. On espère qu’il vous a plu.
Nous, c’est CQFD, plusieurs fois élu « meilleur journal marseillais du Monde » par des jurys férocement impartiaux. Plus de vingt ans qu’on existe et qu’on aboie dans les kiosques en totale indépendance. Le hic, c’est qu’on fonctionne avec une économie de bouts de ficelle et que la situation financière des journaux pirates de notre genre est chaque jour plus difficile : la vente de journaux papier n’a pas exactement le vent en poupe… tout en n’ayant pas encore atteint le stade ô combien stylé du vintage. Bref, si vous souhaitez que ce journal puisse continuer à exister et que vous rêvez par la même occas’ de booster votre karma libertaire, on a besoin de vous : abonnez-vous, abonnez vos tatas et vos canaris, achetez nous en kiosque, diffusez-nous en manif, cafés, bibliothèque ou en librairie, faites notre pub sur la toile, partagez nos posts insta, répercutez-nous, faites nous des dons, achetez nos t-shirts, nos livres, ou simplement envoyez nous des bisous de soutien car la bise souffle, froide et pernicieuse.
Tout cela se passe ici : ABONNEMENT et ici : PAGE HELLO ASSO.
Merci mille fois pour votre soutien !
1 Nombre de ses porte-parole soutiennent Éric Zemmour, le Rassemblement national ou carrément l’Action française.
2 En décembre, Ursula von der Leyen a fait aboutir 25 ans de négociations entre l’Union européenne et le Mercosur (Marché commun du Sud : Argentine, Bolivie, Brésil, Paraguay et Uruguay).
3 Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, dirige aussi la multinationale Avril (Lesieur, Puget, Saipol, etc.) et est leader français de la transformation de graines en huile.
Cet article a été publié dans
CQFD n°238 (février 2025)
Dans ce numéro, un dossier sur la Syrie post-Bachar, avec un reportage sous les bombes turques à Kobané. Mais aussi des nouvelles de Mayotte où il faut « se nourrir, reconstruire et éviter la police ». On se penche également sur une grève féministe antifasciste et sur la face cachée des data centers. Puis on se demandera que faire de la toute nouvelle statue du général Marcel Bigeard, tortionnaire en Algérie, qui vient d’être érigée en Lorraine – un immense scandale.
Trouver un point de venteJe veux m'abonner
Faire un don
Paru dans CQFD n°238 (février 2025)
Par
Illustré par Mortimer, Pirikk
Mis en ligne le 07.02.2025
Dans CQFD n°238 (février 2025)
Derniers articles de Livia Stahl