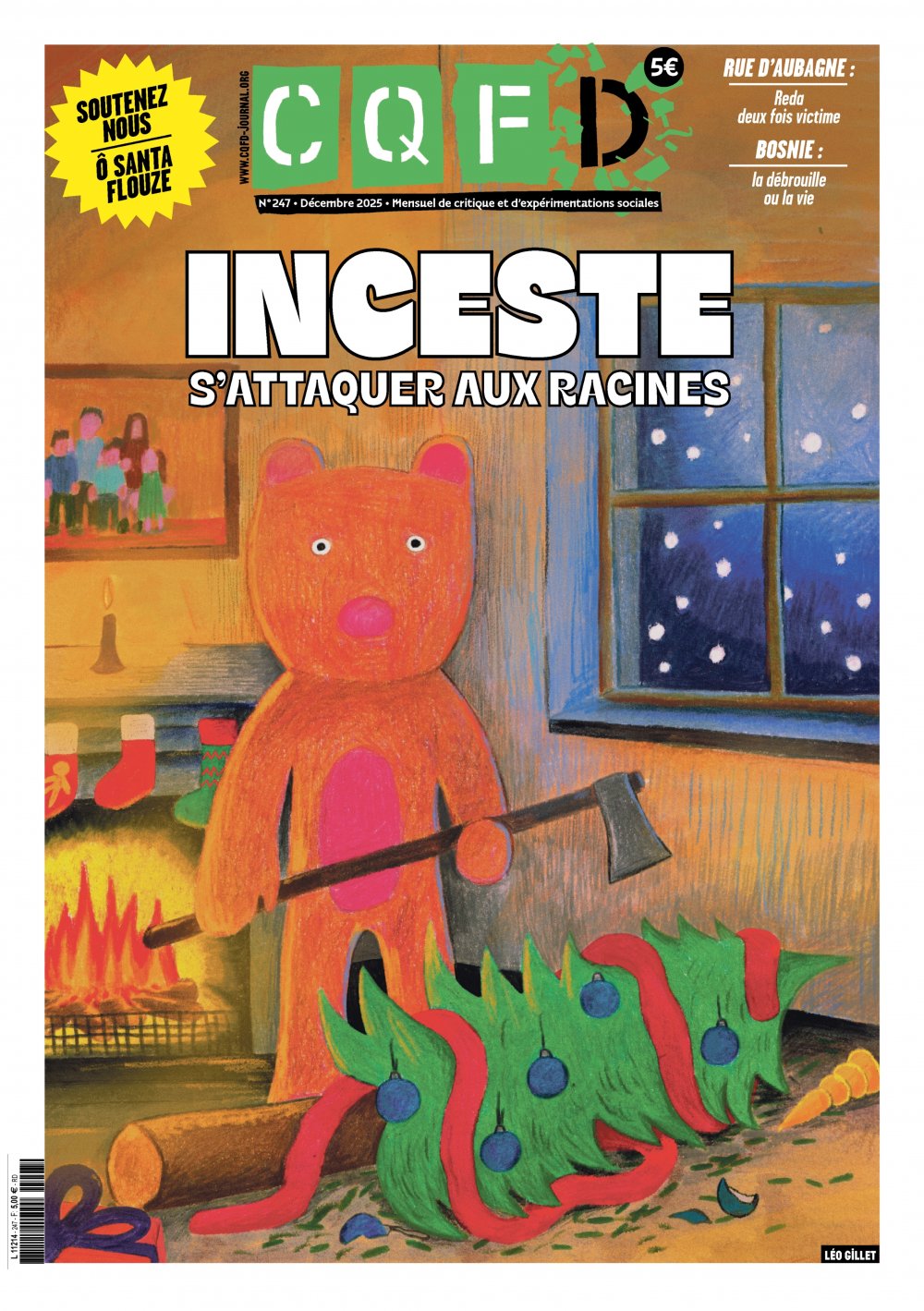Sardaigne à l’huile
À Orgosolo, les murs fédèrent
12 avril 2025. Sur le parvis de l’église d’Orgosolo, village de la région de Barbagia, au centre de la Sardaigne, des journalistes filment de loin le cercueil de Graziano Mesina porté par des croquemorts. Ce célèbre bandit sarde, natif du coin et adepte du trafic de drogue international, vient de casser sa pipe à 83 ans. Dans ces montagnes reculées, les types comme lui sont nombreux à avoir fait courir les carabineros et effrayer les grands propriétaires terriens.
Les bandits n’ont jamais été les seuls à s’opposer aux puissants
Un jeu du gendarme et du voleur qui dure au moins depuis que les colons espagnols, autrichiens, savoyards ou encore piémontais ont tour à tour tenté d’imposer leur loi en Barbagia. Mais dans cette région, les bandits n’ont jamais été les seuls à s’opposer aux puissants. En 1969, les habitant·es d’Orgosolo ont mené une lutte contre un projet de camp militaire de l’Otan près de leur village qui a laissé des traces, et pas des moindres. Partout dans la ville, des peintures murales (i murales) témoignent de cette histoire. Elles mettent aussi à l’honneur la culture locale, les soulèvements et les résistances des peuples face à l’exploitation, au fascisme ou aux guerres… Un lieu de mémoire, de recueillement et d’espoir révolutionnaire à l’heure où les États impérialistes chargent leurs canons.
Au milieu des klaxons de pick-up de bergers qui traversent le centre-ville d’Orgosolo, des familles de touristes bullent devant les murales qui recouvrent les maisons et les commerces. À l’angle d’une rue, on tombe sur la première murale qui représente une femme, allégorie de la justice. Vêtue d’une ceinture tricolore italienne et d’un chapeau aux couleurs du drapeau américain, elle porte une balance penchant du côté des capitalistes au détriment des paysans. Peinte en juillet 1969 par un groupe d’anars milanais Dioniso, elle est une référence directe à la lutte contre l’implantation d’une base militaire de l’Otan à Pratobello, une dizaine de kilomètres au sud d’Orgosolo. À l’époque, dans l’effervescence soixante-huitarde encore très vibrante, des gauchistes d’ici et d’ailleurs viennent prêter main forte aux bergers et paysans du coin pour faire couler ce projet qui menace de les exproprier. Plusieurs jours durant, 3 000 personnes occupent Pratobello. Face à la mobilisation, l’État envoie les gendarmes avant de jeter l’éponge devant la détermination des occupant·es.
Elles représentent les luttes pour l’émancipation de l’humanité tout entière
Partout, des fresques font échos à cette lutte mémorable. Là, une foule mécontente d’habitant·es est accompagnée d’un message de soutien du romancier et homme politique sarde Emilio Lassu « ce qui arrive à Pratobello contre les bergers et agriculteurs c’est de la provocation colonialiste qui nous ramène aux périodes fascistes ! ». Au-dessus, d’anciennes affiches d’époque reproduites en peinture où on peut lire « Pâturages libres des canons et des patrons ! », « Des engrais, pas des balles ! » Plus loin, des grand-mères sardes tiennent tête aux militaires italiens en criant « Dehors l’État militaire ! ». D’autres murales font gloire à la culture locale : on croise des bergers jouant de la flûte et des femmes en train de coudre. Au-dessus de la mairie est reproduite l’affiche du célèbre film Banditi a Orgosolo (1961) qui a consacré le mythe du bandit sarde dans la culture italienne.
La pratique des murales naît véritablement au milieu des années 1970, quand Francesco Del Casino, le prof de dessin d’Orgosolo, prend l’habitude de peindre des fresques engagées avec l’aide de ses élèves et des habitant·es du coin. La pâte gauchiste est évidente, et les peintures à la gloire de la culture et de la résistance locales se mêlent à celles qui représentent les luttes pour l’émancipation de l’humanité tout entière. En montant sur les hauteurs du village, une immense fresque inspirée du célèbre tableau de Delacroix La liberté guidant le peuple représente, à côté de la Marianne révolutionnaire, un jeune palestinien qui s’élance, pierre à la main. Plus loin, des réfugié·es sur un bateau devant une Amérique fortifiée sont accompagné·es du bandeau : « Nous sommes tous des clandestins. »
On traverse aussi l’histoire à travers des évènements connus et moins connus qui donnent parfois le tournis : l’incendie volontaire d’une entreprise new-yorkaise où 129 ouvrières ont perdu la vie en 1908, la Première Guerre mondiale et les vies italiennes fauchées, les grèves et occupations turinoises de 1920 vaincues par les fascistes, un hommage aux partisan·es tombé·es contre Mussolini, la seconde intifada à Gaza en 2000, la guerre d’Irak en 2003 et même les émeutes des banlieues en 2005 en France. Si les peintures appellent à la paix, elles n’oublient jamais de pointer les responsables : un portrait coloré d’Allende est sobrement légendé « 11 septembre 1973 : coup d’État des militaires fascistes chiliens avec l’aide de la CIA ». Non loin de là, le logo de l’Otan est détourné pour former une croix gammée sur fond bleu – de quoi faire sauter au plafond nos plateaux télé et radios nationales.
Aujourd’hui encore, la pratique des murales est encouragée par les locaux et est une étape obligatoire pour les voyageurs de la région. Quitte à devenir trop touristique ? « Ça fait longtemps que ça l’est », raconte le vendeur de la boutique de souvenirs peinte en mémoire de la chute de Franco. « Mon père a ouvert cette boutique en 1978. Entre l’attrait mystérieux pour les bandits sardes et les murales, il a eu le flair, et ça fait tourner l’économie et empêche le village et ceux des alentours de se vider. » C’est que dans la région, peu industrialisée et touchée par l’exode de sa jeunesse, l’économie agricole et pastorale peinent à joindre les deux bouts. « Les peintures sont importantes pour les habitant·es, poursuit-il, pour en faire, il faut déposer une demande à l’asso qui gère pour qu’elle vérifie si vous respectez bien l’identité des murales ». La dernière murale date de 2022 et représente Julian Assange, muselé par le drapeau américain. Mais que dire de la police qui, visiblement gagnée par cet élan artistique, a aussi peint sa devanture, ornée d’un odieux « Nous sommes là pour assurer la paix » ? !
Alors que l’on quitte le village, on s’arrête devant une dernière murale. On y voit un vieil homme en premier plan et, derrière, des soldats blessés revenant du front. Au-dessus est écrit « Heureux un peuple qui n’a pas besoin de héros » – sagesse murale.
Cet article fantastique est fini. On espère qu’il vous a plu.
Nous, c’est CQFD, plusieurs fois élu « meilleur journal marseillais du Monde » par des jurys férocement impartiaux. Plus de vingt ans qu’on existe et qu’on aboie dans les kiosques en totale indépendance. Le hic, c’est qu’on fonctionne avec une économie de bouts de ficelle et que la situation financière des journaux pirates de notre genre est chaque jour plus difficile : la vente de journaux papier n’a pas exactement le vent en poupe… tout en n’ayant pas encore atteint le stade ô combien stylé du vintage. Bref, si vous souhaitez que ce journal puisse continuer à exister et que vous rêvez par la même occas’ de booster votre karma libertaire, on a besoin de vous : abonnez-vous, abonnez vos tatas et vos canaris, achetez nous en kiosque, diffusez-nous en manif, cafés, bibliothèque ou en librairie, faites notre pub sur la toile, partagez nos posts insta, répercutez-nous, faites nous des dons, achetez nos t-shirts, nos livres, ou simplement envoyez nous des bisous de soutien car la bise souffle, froide et pernicieuse.
Tout cela se passe ici : ABONNEMENT et ici : PAGE HELLO ASSO.
Merci mille fois pour votre soutien !
Cet article a été publié dans
CQFD n°241 (mai 2025)
Dans ce numéro, on se penche sur le déni du passé colonial et de ses répercussions sur la société d’aujourd’hui. Avec l’historien Benjamin Stora, on revient sur les rapports toujours houleux entre la France et l’Algérie. Puis le sociologue Saïd Bouamama nous invite à « décoloniser nos organisations militantes ». Hors dossier, on revient sur la révolte de la jeunesse serbe et on se penche sur l’enfer que fait vivre l’Anef (Administration numérique des étrangers en France) à celles et ceux qui doivent renouveler leur titre de séjour.
Trouver un point de venteJe veux m'abonner
Faire un don
Paru dans CQFD n°241 (mai 2025)
Par
Mis en ligne le 05.05.2025
Dans CQFD n°241 (mai 2025)
Derniers articles de Étienne Jallot